Rendre compte du documentaire comme un cinéma de la mise en scène. C’est à partir de cette volonté que s’est imposée l’idée cette année de présenter le travail de trois cinéastes qui sur la cartographie du cinéma se trouvent à des coins opposés du territoire : la première rétrospective française de Claudia von Alemann, cinéaste essentielle du mouvement féministe en Allemagne, qui ne craint pas de mêler les langages et les dispositifs narratifs pour créer une œuvre au croisement des territoires du politique, de l’expérience commune et de l’intime ; James Benning, figure essentielle du cinéma indépendant américain, arpenteur de l’Amérique et témoin de son histoire, qui fait vivre au spectateur l’expérience du temps et de l’espace, de ce que le paysage contient de récit et cache d’événements ; Jean-Charles Hue, qui entre fiction et documentaire, nous plonge au cœur d’une réalité tourmentée, dangereuse, intense, au côté des Yéniches en France ou des laissés pour compte à Tijuana. Le cinéma documentaire est ainsi un vaste territoire aux frontières flottantes, poreuses, aux expérimentations tant formelles que narratives. Ce sont ces expérimentations singulières dont la compétition tente de rendre compte à travers un ensemble de films français et étrangers, longs et courts métrages, de jeunes cinéastes ou de réalisateurs reconnus. C’est aussi l’expérimentation qui est le dénominateur commun de la sélection des premiers gestes documentaires remarquables présentés dans Première Fenêtre par ceux qui seront les cinéastes de demain. Les programmations Front(s) populaire(s) et les séances spéciales complètent cet ensemble de films contemporains qui questionnent et légendent le monde que nous habitons. C’est à un cheminement plus anarchique, sans distinction, que nous invitons aussi les spectateurs de Cinéma du réel. Comme dans un système rhizomatique les films se complètent, les films se regardent : « des films qui se donnent la main » était l’expression de Marie-Pierre Duhamel. Des films qui remettent en jeu les tensions de notre contemporain, en font émerger l’âpre complexité, le frottement, et en même temps l’évidence. Évidence de la persistance coloniale à laquelle sont confrontées les populations des territoires d’outre-mer, comme le racontent les films tournés en Guadeloupe par Martine Delumeau et Malaury Eloi Paisley, à la Réunion par Cécile Laveissière et Jean-Marie Pernelle ou à la Martinique par Florence Lazar. Évidence de la persistance coloniale qui émerge peu à peu de Dahomey, le film de Mati Diop qui ouvre cette année le festival. Le colonialisme toujours dans Soundtrack of a Coup d’Etat, qui fait le lien entre le mouvement des droits civiques aux États-Unis et les luttes d’indépendance en Afrique. Colonialisme encore avec le film de Raphaël Pillosio, Les mots qu’elles eurent un jour : elles, ces combattantes algériennes, magnifiquement filmées par Yann le Masson à leur sortie de prison. Le portrait de ces femmes modernes, engagées et éprises de liberté en 1962 nous rappelle aussi combien le combat contre le patriarcat est loin d’être nouveau, et loin d’être gagné. De féminisme si tel est le nom de ce combat, il sera également question cette année dans le cadre de la rétrospective consacrée à Claudia von Alemann mais aussi dans les films de Claudine Bories, Natacha Thiéry, Sabine Groenewegen, Kumjana Novakova notamment. Occasion de s’arrêter un instant sur l’expérience politique des femmes cinéastes à travers leurs films et leur parcours. Et puis il y a Gaza, non pas l’événement qui vient tout à coup faire irruption et comme un moment de stupeur interrompre le cours de nos existences, mais comme quelque chose qui nous arrive à tous et reconfigure notre lecture du temps présent, des relations humaines et de notre rapport au monde. C’est aussi à l’aune de ce qu’il se passe à Gaza, ici et maintenant, que nous regardons, non seulement les films tournés en Palestine, mais aussi à Sarajevo ou au Haut-Karabagh. Catherine Bizern
-
-
Compétition
De 6 à 216 minutes, du Japon à l’Argentine et de la France à la Chine, les 37 films de la Compétition mettent à l’honneur, cette année encore, la création documentaire contemporaine la plus remarquable, en première mondiale, internationale ou française.
-

Aeroflux
Nicolas Boone
-

Americium
Théodora Barat
-

Arancia bruciata
Clémentine Roy
-

Boolean vivarium
Nicolas Bailleul
-

Capture
Jules Cruveiller
-

Direct Action
Guillaume Cailleau
Ben Russell
-

Gama
Kaori Oda
-

The Garden Cadences
Dane Komljen
-

Homing
Tamer Hassan
-

Imperial Princess
Virgil Vernier
-

La Laguna del Soldado
Pablo Álvarez-Mesa
-

Le Fardeau
Elvis Sabin Ngaïbino
-

Leaving Amerika
Marie-Pierre Brêtas
-

Les Mots qu'elles eurent un jour
Raphaël Pillosio
-

Light, Noise, Smoke, and Light, Noise, Smoke
Tomonari Nishikawa
-

Longtemps, ce regard
Pierre Tonachella
-
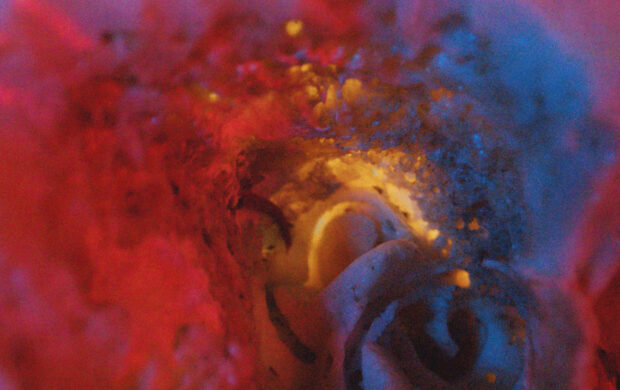
Louis et les langues
Aurélien Froment
-

Marbled Golden Eyes
Kevin Jerome Everson
Lydia Marie Hicks
-

Modèle animal
Maud Faivre
Marceau Boré
-

On the Battlefield
Ray Whitaker
J.P. Sniadecki
Lisa Marie Malloy
Theresa Delsoin
-

Où sont tous mes amants ?
Jean-Claude Rousseau
-

Ozr el wezzah
Mahdy Abo Bahat / Abdo Zin Eldin
-

The Periphery of the Base
Zhou Tao
-

Remanence
Sabine Groenewegen
-

Republic
Jin Jiang
-

Resonance Spiral
Filipa César
Marinho De Pina
-

The Roller, the Life, the Fight
Elettra Bisogno
Hazem Alqaddi
-

Sauve qui peut
Alexe Poukine
-

The Signal Line
Simon Ripoll-Hurier
-

Silence of Reason
Kumjana Novakova
-

Soundtrack to a coup d'état
Johan Grimonprez
-

Sous les feuilles
Florence Lazar
-

Stone, Hat, Ribbon and Rose
Eva Giolo
-

tú me abrasas
Matías Piñeiro
-

Under a Blue Sun
Daniel Mann
-

Voyage à Gaza
Piero Usberti
-

Vuelta a Riaño
Miriam Martín
-
-
-
Première fenêtre
Cette sélection distingue de jeunes créateurs et leurs premiers gestes documentaires, réalisés dans le cadre de leurs formations, issus d’ateliers de réalisation divers, produits par de jeunes sociétés de production ou hors de toute structure.
Elle a été élaborée en collaboration avec un groupe d’étudiantes et d’étudiants.Projetés en salle pendant le festival, où les jeunes cinéastes rencontrent le public, ces films sont également montrés en ligne sur une page dédiée du site Mediapart.fr, où les internautes peuvent voter pour leur film préféré.
-

Camarades
Ulysse Sorabella
-

Des châteaux de sable
Marie Vettese
-

Fatmé
Diala Al Hindaoui
-

I Asked the Factory
Noa Epars
Louis Lamarche
-

Loveboard
Felipe Casanova
-

The Mars Project
Louis Rémy
-

Metamorphosis' Chantings or That Time When I Incarnated as Porpoise
Ainá Xisto
-

Si blanche soit l'ombre
Damien Cattinari
-

Skatepark
Fanny Chaloche
Annabelle Martella
-

Taïauts et Chevreuils
Agathe Simon
-

Un flux
Taryn Everdeen
-
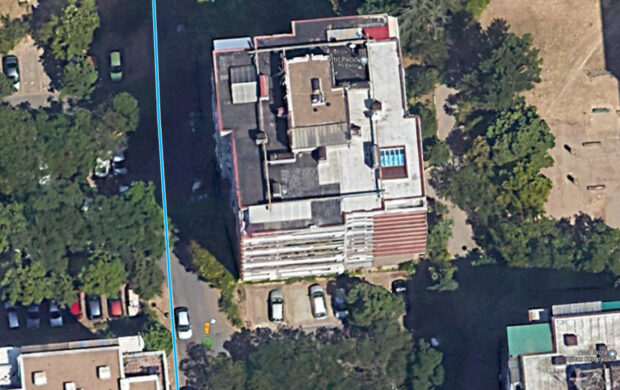
Walks That Won’t Happen
Mina Simendić
-
-
-
Séances spéciales
Les séances spéciales sont un choix de films en avant-première de leur sortie en salle ou de leur diffusion. Un ensemble qui élargit encore notre regard sur la diversité des propositions documentaires contemporaines. Des films qui s’insèrent comme en écho aux autres programmations et qui éclairent notre lecture du temps présent.
-

44 jours
Martine DELUMEAU
-

Atlantiques
Mati Diop
-

Autour d'Exergue – On Documenta 14
-

Chroniques fidèles survenues au siècle dernier à l’hôpital psychiatrique Blida-Joinville, au temps où le Docteur Frantz Fanon était chef de la cinquième division entre 1953 et 1956
Abdenour Zahzah
-

Dahomey
Mati Diop
-
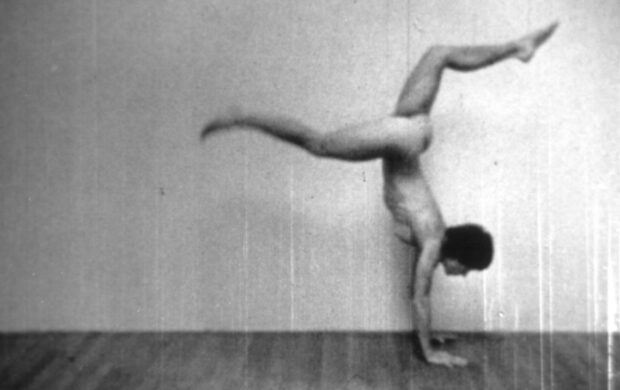
Double Strength
Barbara Hammer
-

Enthousiasme (La Symphonie du Donbass)
Dziga Vertov
-

exergue - on documenta 14
Dimitris Athiridis
-

L'Expérience Zola
Gianluca Matarrese
-

Femmes d'Aubervilliers
Claudine Bories
-

L'Homme-Vertige
Malaury Eloi Paisley
-

L'Ile au trésor
Guillaume Brac
-

Juliette du côté des hommes
Claudine Bories
-

Looking for Robert
Richard Copans
-

Meshes of the Afternoon
Maya Deren
Alexander Hammid
-

Nuit obscure - Au revoir ici, n'importe où
Sylvain George
-
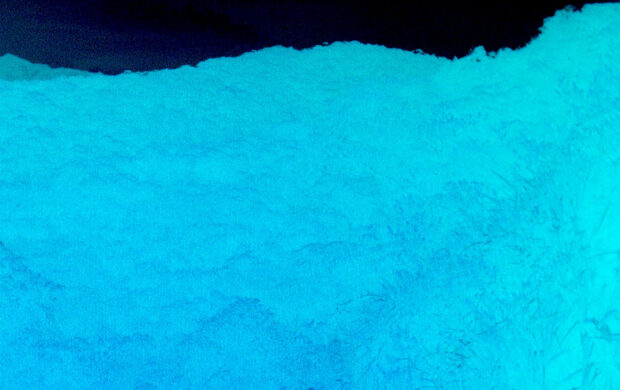
Otherhood
Deborah Stratman
-

Patience, mon coeur
Sophie Bredier
-

Pierre Guyotat, le don de soi
Jacques Kébadian
-

Prove di stato
Leonardo Di Costanzo
-

Route One / USA
Robert Kramer
-

Séance d'écoute : Cheveux en bataille
Clawdia Prolongeau
Clémence Gross
-

Steelmill/Stahlwerk
Richard Serra
Clara Weyergraf
-

Sur une terrasse à Istanbul - Conversation avec Pierre Guyotat
Jacques Kébadian
-

Vever (for Barbara)
Deborah Stratman
-
-
-
Front(s) populaire(s)
Des films où, face à la violence, le geste cinématographique est à la fois celui du témoin mais aussi une reconfiguration du champ de la mémoire, celui du partage de nouveaux principes d’intelligibilité. Chacun et ensemble. De l’engagement des Chrétiens dans les luttes politiques en Amérique latine au récit de l’organisation de la guérilla des FARC en Colombie, c’est l’histoire de la violence des oligarchies d’Amérique latine pour maintenir leurs privilèges qui est revisitée. Cette lutte des plus pauvres pour un meilleur vivre ensemble se retrouve dans la petite communauté d’activistes qui s’est créée sur le rond-point du Tampon à la Réunion. Ici en France, les murs sont les points de ralliement de la lutte contre le patriarcat, l’espace urbain plus que jamais revendiqué comme espace de liberté et d’affirmation d’une révolte collective. Tout au long de la programmation, les situations de violences guerrières se succèdent dans un effet de champ contre-champ, ou plutôt de propagation terrible d’un désastre qui se répète. On se souvient des mots de Jean-Luc Godard dans Notre musique : «Pourquoi Sarajevo? parce que la Palestine». Aujourd’hui c’est le récit du siège de Sarajevo et de la manière dont des cinéastes s’en sont fait les témoins qui nous renvoie inéluctablement à Gaza et sa population sous les bombes, ici et maintenant. Ce sont les images de l’exode d’hommes et de femmes obligés de tout quitter de leurs biens et de leur terre au Haut-Karabagh, chassés par l’armée azerbaïdjanaise qui rendent soudain si concrètes des scènes cruelles que nous savons être celles que vivent les Gazaouis.
La guerre en Palestine. Les films que nous avons choisis, dont l’un a été tourné jusqu’après octobre 2023 (No Other Land) témoignent de ce que signifie l’occupation militaire israélienne ; ils disent aussi le combat des Palestiniens contre l’effacement. Que peut le cinéma? La question posée par les Cahiers du cinéma dans leur numéro de février est aussi la nôtre mais n’est-ce pas une question que chaque film soulève de manière singulière et propose à son spectateur d’expérimenter? Front(s) populaire(s) tente de créer les conditions de cette expérimentation.
Catherine Bizern
-

Les 54 premières années - Manuel abrégé d'occupation militaire
Avi Mograbi
-

La Concorde
Sylvestre Meinzer
-

Cosmocide
Nicolas Klotz
Elisabeth Perceval
-

Des cris déchirent le silence
Natacha Thiéry
-

L'Evangile de la révolution
François-Xavier Drouet
-

Far From Michigan
Silva Khnkanosian
-

Guerilla des Farc, l'avenir a une histoire
Pierre Carles
-

No Other Land
Basel Adra
Hamdan Ballal
Yuval Abraham
Rachel Szor
-

Point virgule
Claire Doyon
-

QUE PEUT LE CINÉMA AU 21e SIÈCLE ?
-

R21 AKA Restoring Solidarity
Mohanad Yaqubi
-

Se souvenir d'une ville
Jean-Gabriel Périot
-

Terla ta nou (Cette terre nous appartient)
Cécile Laveissière
Jean-Marie Pernelle
-
-
-
Claudia von Alemann
En novembre dernier la programmation feminist elsewheres à l’Arsenal de Berlin commémorait le premier séminaire international du film féministe qui s’était tenu 50 ans plus tôt à l’initiative de Helke Sander et Claudia von Alemann, qui reste une figure essentielle du mouvement cinématographique féministe en Allemagne.
Au sortir de ses études à l’institut du film de Ulm où elle côtoie notamment Alexander Kluge, dans l’effervescence de la fin des années 60, Claudia von Alemann, part filmer le très chahuteur festival du film expérimental de Knokke-le-Zoute, participe au mouvement des étudiants à Paris et retrouve les fondateurs du parti des Black Panthers à Alger. Mue par ce désir partagé par d’autres de produire des films de contre-information, elle l’est aussi par celui de se libérer des formes conventionnelles. Tout au long de son œuvre, elle empruntera tour à tour aux différents langages cinématographiques, qu’elle mêlera le plus souvent, depuis les formes expérimentales au documentaire engagé, du film à la première personne à la fiction historique.
L’histoire du féminisme du XIXe siècle tient une grande place dans son travail d’auteur – elle y consacre un ouvrage et deux films – mais à l’image de Flora Tristan qui pense que l’émancipation de la classe ouvrière passera forcément par la libération des femmes, son cinéma vise aussi au présent le patriarcat et le capitalisme, frontalement dans Ce qui importe c’est de le transformer en 1972 mais aussi dans Nuits claires et ses films tournés ensuite en Thuringe après la chute du mur de Berlin.
Après Nuits claires, ses films réalisés dans sa région natale mettent en jeu sa propre histoire et celle de sa famille, et éclairent les angles morts de l’Histoire allemande. Plus directement biographique, son cinéma nous dit alors qu’il n’est pas possible de parler des autres sans parler de soi, de parler d’Histoire sans engager sa propre histoire.
Dans Feminist Worldmaking and the Moving Image, catalogue de l’exposition No master territories¹, est reproduit un texte de la cinéaste datant de 1976 qui interroge le terme «collectif», soulignant sa force de pensée, de résistance et d’action. Le collectif constitue sans doute un des arguments de Claudia von Alemann, de son désir de cinéma, de son engagement de cinéaste féministe.
Ainsi, si l’intime est politique, l’expérience commune et la politique de l’amitié, la sororité, dirions-nous aujourd’hui, mise en scène dans Le siècle prochain nous appartiendra et mise en œuvre dans Nuits claires est part de création, comme le montre avec délicatesse son dernier film, consacré à la photographe et amie Abisag Tüllmann.
Catherine Bizern
_____
¹Conçue par Hila Peleg et Erika Balsom cette exposition était visible en 2023 à la Maison des cultures du monde de Berlin et au Musée d’Art Moderne de Varsovie.
-

...ce qui importe, c'est de le transformer
Claudia von Alemann
-

Ce n'est qu'un début, continuons le combat
Claudia von Alemann
-

Comme les ombres nocturnes - Retour en Thuringe
Claudia von Alemann
-

Denny, Fourmi et les autres
Claudia von Alemann
-

DISCUSSION AVEC CLAUDIA VON ALEMANN
-

Exprmtl 4 knokke
Claudia von Alemann
-

La Femme à la caméra - Portrait de la photographe Abisag Tüllmann
Claudia von Alemann
-

Kathleen et Eldridge Cleaver à Alger
Claudia von Alemann
-

L’EXPÉRIENCE POLITIQUE DES FEMMES CINÉASTES, PARCOURS SINGULIERS
-

November
Claudia von Alemann
-

Nuits claires
Claudia von Alemann
-

Ombres de la mémoire
Claudia von Alemann
-

Par leurs propres moyens - Femmes au Vietnam
Claudia von Alemann
-

Rencontre : L'intime et le politique
-

Le siècle prochain nous appartiendra
Claudia von Alemann
-

Le Voyage à Lyon
Claudia von Alemann
-
-
-
James Benning
La dernière rétrospective parisienne consacrée à James Benning remonte à 2009, une année charnière pour le cinéaste américain alors sexagénaire. Tous les films d’une œuvre alors peu montrée en France avaient été projetés deux fois au Jeu de Paume dans leur 16mm d’origine, tandis que Ruhr, son tout premier en numérique haute-définition, avait été dévoilé en clôture au CENTQUATRE pour une salle comble. Provoqué par une longue série d’accidents de développement et de projection, le passage à la vidéo fut sans retour. Le cinéaste sut convertir la contrainte en aubaine, et trouver dans le numérique des possibilités de durée, de fixité et de netteté jusque-là inaccessibles, dont le septième plan de Ruhr, long d’une heure, offrait un premier exemple impressionnant.
Quinze ans plus tard, on sait à quelle abondante floraison l’outil numérique a contribué, au point qu’il est difficile de quantifier exactement le nombre de films que Benning a tourné depuis 2009. Cette seconde grande rétrospective ne reprend pas l’œuvre là où la première l’avait laissée. Benning a lui-même conçu un programme hétéroclite, mêlant les époques, les formats, les durées, les « saveurs », insistant toutefois dans le court texte de présentation rédigé à cette occasion sur une veine biographique qui irrigue son travail de manière toujours surprenante : « Je pense que plus vous en verrez, plus vous apprendrez à me connaître. Je suis là, dans mon travail. »
Certains classiques s’y trouvent, restaurés depuis le début des années 2010 par le Filmmuseum de Vienne (Landscape Suicide, 11×14, American Dreams (lost and found), Four Corners), d’autres manquent et font place à des raretés (SAM, two moons, John Krieg exiting the Falk Corporation). Pas de RR ni de TEN SKIES – peut-être les deux films les plus radicalement limpides de la période analogique – mais 13 Lakes, qui observe dans des plans de dix minutes les effets de la lumière sur la surface de grands lacs américains, soit la plus pure application d’une idée fondamentale pour le cinéaste selon laquelle le paysage est fonction du temps. Les deux versions distantes d’un demi-siècle de The United States of America sont au programme, de même qu’un échantillon d’un long travail mené autour de vies solitaires et dissidentes comme celle de l’Unabomber Theodore Kaczynski (Stemple Pass), ou un éloge de la lecture en quatre portraits, parmi lesquels ceux de l’écrivaine Rachel Kushner et de la chorégraphe Simone Forti (READERS). Certains seront peut-être surpris de voir un jeune Willem Dafoe à l’affiche d’O Panama, mais ce serait oublier les liens originels de ce cinéma réputé austère avec la fiction. À chacun de faire son chemin à travers ces treize séances qui ne manqueront pas, comme le fait chaque film, de vous donner d’elles-mêmes les clés pour les lire.
Cette idée selon laquelle un film vous apprend avant toute chose à le regarder est présente d’emblée dans les films de Benning et constitue l’une des raisons premières de leur exigence et de leur attrait. Passionné par les mathématiques, qu’il a enseigné avant de faire des films, il invente des structures qu’il conçoit comme des problèmes à résoudre. Son cinéma s’inscrit dans une histoire de l’avant-garde américaine postérieure au lyrisme de Stan Brakhage ou Maya Deren et dans la continuité du film structurel. Le critique P. Adams Sitney a marqué l’avènement de celui-ci en 1969 (2) et l’a par la suite défini dans Le Cinéma visionnaire comme un cinéma « dans lequel la forme d’ensemble, prédéterminée et simplifiée, constitue l’impression principale produite par le film. » Mais Benning arrive après l’apogée de ce courant. Dans un livre qu’elle a récemment consacré à TEN SKIES, (3) Erika Balsom écrit que « la pratique de Benning, en particulier telle qu’elle s’est développée dans les années 80 et 90, est mieux comprise comme faisant partie d’une réponse multiforme au moment de haute modernité du cinéma d’avant-garde », perçu comme une impasse dont le retour à des éléments de contenu, qu’ils soient historiques, politiques, personnels ou narratifs, aura permis de sortir.
Si les premiers films se caractérisent par de telles constructions formelles, les expérimentations sur la structure métrique, sur la composition, le son et la lumière s’accordent très tôt aux expérimentations narratives. Elles s’imprègnent d’un humour qui doit aussi bien à Jacques Tati qu’à la photographie et à l’art américains de cette période – Benning a notamment cité George Landow, William Wegman, Clayton Bailey ou même Vito Acconci, aux côtés de ses propres figures tutélaires, Michael Snow, Hollis Frampton et Andy Warhol (auxquels s’ajoutent souvent les noms d’Yvonne Rainer, Jean-Luc Godard, Chantal Akerman ou Nancy Holt).
11×14 (1977) présente par exemple soixante-cinq plans-séquences méticuleusement composés et orchestrés, entrecoupés de ponctuation noires, pour la plupart statiques mais présentant parfois quelques mouvements d’appareil, et de longues séquences embarquées dans les habitacles d’une voiture ou d’un métro aérien. Dans ces plans interviennent des personnages récurrents qui insinuent des fictions équivoques : celles d’un homme marié entretenant une liaison, d’une femme et de sa compagne traversant le Midwest, et d’un autostoppeur cherchant du travail. Cette matière narrative ne relègue pas le paysage ou les caractères formels à l’arrière-plan. Le spectateur cherche tout autant le récit que le système régissant la structure. Le retour de motifs visuels, sonores et narratifs distants fabrique un espace sphérique dans lequel le spectateur peut voir l’action se développer le long de plusieurs coordonnées spatiales et temporelles clairement situées.
Les très longs plans fixes pour lesquels Benning est connu, et dont témoignent par exemple les quarante-cinq minutes en plan fixe de L Cohen (grand prix de la quarantième édition de Cinéma du Réel en 2018), n’auraient pas été possibles sans une vie passée à sillonner de manière solitaire le territoire américain pour fabriquer des plans. En explorant les possibilités du cadre, il fait prendre conscience de leurs limites tout en les élargissant dans toutes les directions à travers les relations du son et de l’image et le travail du hors-champ. Les films des années 1970 regorgent de ce type de jeux formels parfois à la limite du gag, comme dans 11×14, ce personnage courant en sens inverse d’un travelling le long du trottoir d’un quartier résidentiel, et qui fait un retour surprise dans le plan par le côté opposé, comme si le plan n’était que la surface visible d’un espace sphérique. Benning disait d’un autre plan similaire dans One Way Boogie Woogie (1977) : « j’aime l’idée que lorsque l’on se tient sur terre, un point à un pied sur votre gauche est simplement ça, à un pied sur votre gauche. Mais si vous choisissez d’y aller par la droite, c’est un voyage de 41 851 445 pieds » (4), comme une circumnavigation. Pour Benning, les images sont toujours juste des images. À la fois surfaces et fenêtres, elles invitent à une réflexion sur leurs propriétés, leur contenu, et sur notre propre présence face à elles.
Les films de cette époque ne peuvent en effet être réduits à leur composantes formelles, et montrent d’emblée des préoccupations d’ordre politiques et sociales. Elles concernent la classe ouvrière dont le cinéaste est issu (en 1972 dans Time and a Half, dont John Krieg exiting the Falk Corporation étend plus tard un segment de 14 secondes sur 71 minutes), les conflits raciaux dont il a été témoin dès son enfance à Milwaukee, l’impérialisme américain ou les problématiques de genre, notamment dans les films co-réalisés avec la cinéaste Bette Gordon. Co-réalisé avec celle qui signera quelques années plus tard Variety (1983), The United States of America (1975) est un road-movie dans le sens le plus pur du terme, où la caméra installé sur la banquette arrière filme les deux cinéastes conduisant alternativement d’Est en Ouest sur les routes nord-américaines apparaissant à travers le pare-brise, tandis que la radio donne notamment des nouvelles de la guerre du Vietnam. Un travelogue contemporain se superpose au mouvement de la Destinée manifeste et à une autre conquête d’un territoire si lointain et si proche.
C’est dans les années 1980 que le cinéma de Benning importe une vaste matière documentaire visuelle ou écrite, relative aux diverses façons dont les actions humaines marquent le territoire américain, à l’histoire de la colonisation, à l’indigénéité et au racisme, à la culture populaire, aux figures d’assassins, aux particularités du Midwest. American Dreams (lost and found) (1984) superpose par exemple trois récits simultanés. Sa bande-son donne à écouter des fragments radiophoniques constitués de publicités, de discours politiques, d’interviews de célébrités, et des chansons emblématiques des années auxquelles la matière visuelle se rapporte. L’image donne à voir une collection de cartes de baseball retraçant la carrière du joueur noir Hank Aaron, sous lesquelles défilent des sous-titres manuscrits empruntés au journal d’Arthur Bremer, un homme blanc qui projetait de tuer Nixon et tira finalement sur le gouverneur George Wallace, et qui parfois laissent penser que l’auteur en serait le cinéaste lui-même.
Découpé en deux parties, Landscape Suicide (1986) associe paysages physiques et psychologiques de deux meurtres perpétré en Californie et dans le Wisconsin, tous deux ayant à voir avec l’isolement. Ce film célèbre met en scène le témoignage de chaque assassin, une adolescente californienne ayant tué une camarade et le tueur en série Ed Gein, en filmant également les lieux où ils vécurent et perpétrèrent leurs crimes. Tout le travail mené plus tard par Benning autour des figures de Thoreau et de Kaczynski et l’ayant conduit à reproduire leurs cabanes respectives, approfondissent cette réflexion sur ces figures ambigües d’homme blancs solitaires.
Four Corners brouille de la même manière les limites entre le personnel et le politique. Le titre désigne une région de l’Ouest nord-américain à l’intersection des quatre états de l’Arizona, du Colorado, du Nouveau-Mexique et de l’Utah. Découpé en quatre parties complexes et structurées à l’identique, le film présente la biographie d’un artiste, suivi de l’une de ses peintures, accompagnées par le récit historique d’un lieu en relation avec des vies individuelles et des migrations collectives, puis par treize plans des lieux décrits. Sauf que l’un de ces lieux, très éloigné de la région des Four Corners, est le Wisconsin natal de Benning, qui lit un texte autobiographique sur son enfance à Milwaukee, son appartenance à la communauté germano-américaine qui a commencé d’y émigrer au cours du siècle précédent, les conflits raciaux entre communautés ouvrières, et sa propre participation à une manifestation pour les droits civiques qui lui valut d’être battu par d’autres enfants pauvres et blancs. Autre écart, l’image d’authentiques pétroglyphes amérindiens du deuxième siècle après J.-C. sont introduits par la biographie d’une artiste fictive. Ces éléments, assemblés sur le canevas d’une structure mathématique élégante, ne sont soulignés par aucune causalité autoritaire ; de même que Benning insère sa propre histoire entre celles des paysages et des vies qu’il présente, de même laisse-t-il à chacun la place de méditer sur la sienne.
L’objet d’art est toujours moins important que l’acte de regarder et d’apprendre par soi-même. Benning a longtemps donné un cours intitulé « Looking and Listening » au Californian Institute of Arts, durant lequel il partait en excursion avec ses étudiants dans des lieux divers, en leur demandant d’écrire à propos de ce qu’ils voyaient depuis un point précis. Une telle logique l’a amené à copier les œuvres d’artistes folk tels que Bill Traylor ou Moses Tolliver pour comprendre leur facture véritable et examiner sa vie à la lumière de celles d’autres figures d’outsiders.
Le travail sur les cabanes a été l’aboutissement de cette quête d’attention et d’introspection. Nightfall (2012) met précisément en œuvre, en un plan de 98 minutes à la tombée de la nuit, la qualité de concentration que le cinéaste a pu décrire : « Nous ne ne cherchons plus à être attentifs ; nous sommes bombardés par trop de choses, nous avons trop à faire. Le fait d’être dans la cabane m’aide à conserver une capacité d’attention qui me permet de regarder, d’écouter et de ressentir profondément. Dans les bois, tout est important, qu’il s’agisse d’une trace sur le sol ou d’un bruit au loin. La relation à l’environnement est totalement différente. » (5) Le travail des cabanes a été aussi l’occasion de mesurer ce qui a pu changer entre l’époque où Thoreau résidait au bord de l’étang de Walden, écrivant sur le passage lointain d’un train à vapeur, et celle où Kaczynski fulminait contre le survol permanent d’hélicoptères et d’avions au dessus des forêts du Montana où il s’est caché pendant plus de vingt ans. Benning a réalisé différents films autour de ces cabanes, Two Cabins (2011) mettant les deux en relation tandis que dans Stemple Pass (2012), à travers quatre plans d’une demi-heure pour chaque saison de l’année, le cinéaste s’inscrit à la place de l’Unabomber dont il lit différents écrits publics et privés.
C’est à la fin des années 1990 qu’après une décennie dominée par le texte, les films se font de plus en plus laconiques pour laisser parler les paysages. Constitués chacun de trente-cinq plans fixes de deux minutes trente, les trois films de la trilogie californienne (El Valley Centro, Los et Sogobi) font constamment allusion aux forces politiques qui s’exercent sur les paysages de la région. À travers un regard soutenu dans la durée, l’attrait dangereux d’une nature idéalisée et mythifiée s’évapore pour laisser apparaître de multiples formes d’empiètement. Les treize plans de dix minutes qui composent 13 Lakes n’offrent pareillement au regard une beauté rassérénante que pour nous inviter à voir par nous mêmes les signes de présences qui l’inquiètent – bruits de coups de feu, de voitures, de trains et de bateaux, jusqu’à la mer de Salton en proie à une catastrophe écologique notoire.
Dès lors que cette pratique a été libérée des contraintes métriques du cinéma argentique, cette discipline de l’attention a pu s’épanouir dans des durées jusqu’alors impossibles. Tandis que les six premiers plans de Ruhr reproduisent le format des plans de 13 Lakes et TEN SKIES, le septième atteint une durée d’une heure. Plusieurs films de la période numérique ne sont constitués que d’une seule vue, tels que Nightfall, L Cohen, ou BNSF (2013), qui étend sur un plan de plus de trois heures le motif ferroviaire de RR.
C’est le cas à nouveau pour BREATHLESS, un plan tourné fin 2023 qui reproduit la durée d’À bout de souffle mais remplace son récit par celui qui se met discrètement en place en bordure d’une petite route des montagnes de Sierra Nevada. Suscité par une curiosité pour un arbre atypique, le plan finit par déployer toute une dramaturgie permettant de saisir son contexte. Une équipe d’élagueurs travaille sur l’arbre, avant d’aller s’occuper d’un autre hors-champ. Un hélicoptère fait craindre la présence d’un de ces nombreux incendies qui l’année dernière ont ravagé la région, mais c’est un véritable exercice militaire qui se livre bientôt au-dessus de nos têtes, rappelant combien l’expérience de la beauté ne saurait plus couvrir le bruit des chars.
Antoine Thirion
(1)https://jeudepaume.org/evenement/james-benning-retrospective/
(2)« Soudain, un cinéma de structure a vu le jour » écrit-il dès l’entame d’un essai pour la revue Film Culture.
(3) Fireflies Press, Decadent Editions, 2021
(4) « Off Screen Space / Somewhere Else », traduit par Paul Michel pour la revue Débordements : https://debordements.fr/james-benning-off-screen-space-somewhere-else/
(5) « James Benning talks about Two Cabins », Artforum, 28 mars 2012.
https://www.artforum.com/columns/james-benning-talks-about-two-cabins-199805/Lire l’entretien avec James Benning réalisé à l’occasion de la rétrospective.
-

11 x 14
James Benning
-

13 Lakes
James Benning
-

American Dreams (lost and found)
James Benning
-

BREATHLESS
James Benning
-

Discussion avec James Benning
-

Four Corners
James Benning
-

John Krieg exiting the Falk Corporation in 1971
James Benning
-

Landscape Suicide
James Benning
-

O Panama
James Benning
Burt Barr
-

READERS
James Benning
-

Ruhr
James Benning
-

SAM
James Benning
-

Stemple Pass
James Benning
-

two moons
James Benning
-

The United States of America (1975)
James Benning
-

THE UNITED STATES OF AMERICA (2021)
James Benning
-
-
-
Jean-Charles Hue
D’un côté, un territoire lointain : la Zona Norte de Tijuana, la misère de ses trottoirs souillés où déambulent des vies fantômes, embouties par la drogue, gouvernées par la foi, ne comptant sur aucun secours et fuyant le moindre regard. Là-bas, Jean-Charles Hue a tourné quatre courts métrages (cinq si l’on compte Pitbull Carnaval, galop d’essai de 2006 à l’autre bout du Mexique et valant préambule) et trois longs, répartis entre documentaires purs, fictions revendiquées, et hybridations diverses. De l’autre côté, un territoire lointain de l’intérieur, sans frontières visibles, formé en france par une communauté yéniche autour de l’autorité souveraine du dénommé Fred Dorkel. Quasiment le même nombre de films qu’au Mexique, et dans une commune indifférence aux lignes de partage usuelles entre fiction et documentaire.
Le choix de ces deux terrains est rien moins qu’indifférent au refus de départager le règne de la fiction de celui du documentaire, tant il est évident que dans ces deux monades, dans la radicale altérité de leurs rites, le cinéaste est parti chercher un mariage voisin de contingence crue (misère, violence, peur qui couve sous la moindre chose) et de pensée magique (miracles yéniches ou mexicains, superstition partout). Disons d’ailleurs, plus simplement : mélange de concret et de magie. Car si ces films, jusque dans leurs replis les plus fictionnels, ont des vertus ethnographiques tout à fait évidentes, leur intérêt pour la vie spirituelle répond à des motivations assez peu académiques.
Entamée il y a plus de vingt ans, cette oeuvre têtue dont Cinéma du Réel fait aujourd’hui la rétrospective a été inaugurée par une question qu’il est difficile d’imaginer plus programmatique. On l’entend sans voir celui qui la pose, dans Emilio : c’est Jean-Charles Hue, il est derrière la caméra, il a à peu près trente ans et le cinéma est en train de l’arracher à un vague destin dans l’industrie de la mode. « En quoi tu crois ? », interroge-t-il le vieil Emilio, chanteur de flamenco et ami, rencontré lors d’un séjour en Catalogne, chez les Gitans. La question vient sans préalable ni la moindre précaution introductive (c’est dire s’il brûlait de la poser) : elle est elle-même le préalable. Dans le fatras d’événements réels et fictionnels à quoi les films les confrontent (affaires quotidiennes souvent compliquées par une existence aux confins ; déclarations fraternelles ou amoureuses ; affaires criminelles plus d’une fois, larcins, drogue ; parfois presque rien, juste un corps planté dans le décor, un regard qui s’absorbe dans le lointain), tous, la famille Dorkel comme la coterie d’éclopés des trottoirs de Tijuana, finissent toujours par répondre à cette question, qu’il n’est plus nécessaire de poser : en quoi croyez-vous ?
Pour justifier cette idée fixe, on peut spéculer sur deux causes, d’ailleurs assez peu démêlables. L’une serait intime, une tocade d’enfant devenue un motif d’artiste, comme souvent. Jean-Charles Hue évoque parfois une grand-mère, qui l’a un peu élevé et qui avait parfois des visions. La grand-mère avait des racines gitanes et mesurait chaque matin sur son buffet le déplacement d’un vase, car ce vase, chaque nuit, elle n’en doutait pas, changeait de position pour la faire enrager, et parce qu’il y a de la magie dans toute chose. C’est dans cette atmosphère de croyance confuse qu’a poussé le goût de Jean-Charles Hue pour le cinéma, et certains films en particulier. Il y a par exemple ce récit de tournage de Voyage au bout de l’enfer, qu’il raconte avec gourmandise. Pour la scène grandiose du mariage, Michael Cimino avait demandé à la foule de ses figurants russes incarnant les invités de venir avec de faux cadeaux, et les figurants en avaient amené de vrais, puis, plusieurs fois après le tournage, avaient écrit pour prendre des nouvelles des mariés. Ce que Jean-Charles Hue demande au cinéma, et au sien au premier chef, c’est de le faire croire à ce qu’on lui raconte avec la conviction inébranlable de ces figurants russes.
L’autre explication est pragmatique : entrer dans la croyance des gens qu’il filme, de Fred Dorkel qui a vu le diable, de Yolanda ou Mimosa qui ont leurs propres superstitions, c’est fabriquer un terrain d’entente en les mettant à égalité avec le cinéma. Que les films, de l’un à l’autre, penchent plus ou moins côté fiction ou côté documentaire, le « personnage » est ce terrain de négociation où le filmeur et le filmé essaient de trouver une vérité ensemble, dans une transe qui les unit. La foi des personnages dans ce qui les travaille y est ainsi l’appui de celle du spectateur pour ce qu’on lui raconte. Méliès, en qui Godard ne voyait pas pour rien un grand documentariste, a donné un jour cette définition adéquate du métier de réalisateur de cinéma : le réalisateur, c’est celui qui rend réel. Un magicien, donc, un genre d’alchimiste penché sur son chaudron, essayant divers dosages.
Comme la plupart des cinéastes qu’il admire (Pialat notamment, qu’il nomme aussi souvent que Cimino), Jean-Charles Hue fait du cinéma contre le cinéma. C’est-à-dire pour lui arracher quelque chose, profiter de l’aspiration de sa prodigieuse mécanique pour lui subtiliser une magie qui n’est pas littéralement celle de ses personnages, mais qui resterait introuvable sans elle. Chaque film de plus, sur chacun des deux territoires qu’il arpente obsessionnellement, est l’expérience recommencée d’un dosage, un nouveau réglage des intensités de la fiction et de celles du documentaire, correspondant chaque fois à un degré d’intimité différent avec ses personnages. Parfois (sur le versant le plus expérimental, celui par exemple de Tijuana jarretelle, le diable), il ne leur est même plus besoin d’apparaître – les histoires qu’ils ont racontées suffisent, déposées sur un lit d’images abstraites qui sont une autre approche possible du portrait. Quelques éclats de lumière sur des breloques, un rayon de soleil qui tape sur le capot d’une voiture : souvent, des choses qui brillent. Pour la magie qu’il essaie d’arracher au cinéma, Jean-Charles a un mot : les « brillances », justement. « Je plonge dans les brillances », dit-il, pensant aux bijoux des dames blanches de Tijuana, mais assurément aussi au miracle lumineux qui a fait du cinéma sa religion.
Jérôme Momcilovic
-

Un ange
Jean-Charles Hue
-

La BM du seigneur
Jean-Charles Hue
-

Carne viva
Jean-Charles Hue
-

DISCUSSION AVEC JEAN-CHARLES HUE
-

Emilio
Jean-Charles Hue
-

Mange tes morts - Tu ne diras point
Jean-Charles Hue
-

La mort vient sans prévenance
Jean-Charles Hue
-

L'Œil de Fred
Jean-Charles Hue
-

Perdonami mama
Jean-Charles Hue
-

Pitbull carnaval
Jean-Charles Hue
-

Quoi de neuf docteur ?
Jean-Charles Hue
-

The Soiled Doves of Tijuana
Jean-Charles Hue
-
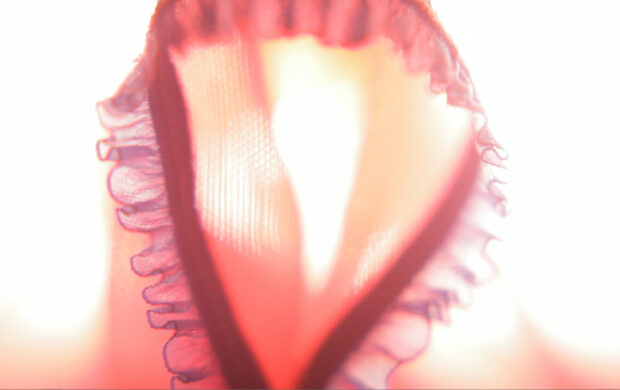
Tijuana jarretelle, le diable
Jean-Charles Hue
-

Tijuana Tales
Jean-Charles Hue
-

Topo y Wera
Jean-Charles Hue
-

Y a plus d'os
Jean-Charles Hue
-
-
-
Toute une nuit - Hommage à Marie-Pierre Duhamel
Grande programmatrice, Marie-Pierre Duhamel-Müller fut déléguée générale de Cinéma du réel de 2005 à 2008 mais elle fut bien plus que cela.
C’est à la formidable passeuse qu’elle était que nous rendons hommage cette année à travers une programmation emblématique de ses choix et de ses découvertes. Une nuit pour nous rappeler sa curiosité, son érudition, son inspiration et son humour.___
Dans la nuit du samedi 30 au dimanche 31 mars de 19h30 à 8h.
Cette nuit se termine par un petit déjeuner offert aux spectateurs.
-

A Day To Remember
Wei Liu
-

Besitzbürgerin Jahrgang 1908
Alexander Kluge
-

Between the Devil and the Wide Blue Sea
Romuald Karmakar
-

Broadway By Light
William Klein
-

Le ciel tourne
Mercedes Álvarez
-

La Fabrique du Conte d'été
Françoise Etchegaray
Jean-André Fieschi
-

Frau Blackburn, geb. 5 Jan. 1872, wird gefilmt
Alexander Kluge
-

Gita Govinda
Amit Dutta
-

Histoire de la nuit
Clemens Klopfenstein
-

Images d'Orient, tourisme vandale
Yervant Gianikian
Angela Ricci Lucchi
-

Nocturne
Emily Richardson
-

Les Nuits électriques
Eugène Deslaw
-

Several Friends
Charles Burnett
-

Venise n'existe pas
Jean-Claude Rousseau
-

Le Voyage poétique
Huang Wenhai
-
-
-
Festival parlé
Bien avant qu’un réseau de luttes locales ne s’oppose à l’appropriation de l’eau par des intérêts particuliers ou qu’une communauté hétéroclite de paysans, militants et simples habitants ne s’organise pour défendre un bocage menacé par la construction d’un aéroport, l’accès à des ressources vitales et la défense d’espaces partagés a constitué l’horizon des communs. Dès la généralisation des enclosures dans l’Angleterre du XVIIe siècle, point de départ d’un processus d’« accumulation primitive » que Marx désignait comme l’origine du capitalisme, et aussi longtemps que des logiques privatives ont prévalu sur l’intérêt collectif, les communs ont été menacés. Leur préservation a pourtant à voir avec nos conditions mêmes d’existence, car ils concernent d’abord les ressources indispensables à notre survie, l’eau, la terre, les forêts, tout le tissu biologique que nous partageons avec les autres vivants.
Par-delà des biens matériels, les communs définissent aussi des relations sociales, celles qui, par exemple, assurent équitablement la gestion collective de ces ressources partagées : communautés d’expérience et de savoirs qui, des jardins partagés aux logiciels libres, des coopératives ouvrières aux fab labs autogérés, inventent une praxis politique à l’échelle d’un collectif. Voilà comment ces expérimentations et ces insurrections concernent aussi bien la politique que l’esthétique, en qualifiant des formes de vie qui engagent tout à la fois l’environnement et la manière de l’habiter, la terre et les moyens de la travailler, la communauté et la façon dont elle se représente et se raconte à elle-même. Car œuvrer à la préservation des communs, c’est aussi faire en commun, transmettre et collectiviser les outils, les savoirs et les pratiques. Dans l’histoire des formes documentaires, ce partage équivaut au souci de pluraliser les regards, collectiviser l’écriture des récits, repenser la logique même de la création afin que l’élaboration importe au moins autant que le résultat. Cela revient à composer avec des désirs divers pour faire en sorte qu’un projet, quelle que soit sa forme, soit aussi l’occasion de se réapproprier des outils pour se représenter et refonder ainsi une communauté d’expérience.
De la cartographie au cinéma et de la philosophie à la militance, la cinquième édition du festival parlé questionne avec « Communs, Communes » un enjeu fondamental des temps présents et à venir. À travers les expériences de communalisation et les luttes de défense des communs, il s’agit d’envisager non seulement les espaces, ressources et histoires que nous partageons, mais aussi les gestes, savoirs et images à même de proposer une alternative radicale aux récits dominants.
La première table ronde, « Formes communes », emprunte son titre à Kristin Ross pour interroger une proposition de Maria Mies, « Pas de communs sans communauté ». Elle s’ancre dans le récit et l’analyse des expériences communalistes, élaborées par des collectifs militants aussi bien qu’à travers des agencements plus éphémères, geste chorégraphique, expérience de tournage ou mobilisation, autant de formes communes qui viennent refonder une communauté non sur une essence de quelque sorte mais sur un faire commun ne dissociant jamais la pensée de l’expérience.
La seconde table ronde, « L’horizon des communs », adopte une perspective à la fois diachronique et synchronique pour ressaisir un phénomène aux échelles et dimensions multiples, à partir de démarches qui croisent le temps long de l’histoire et des paysages avec l’actualité la plus urgente. Gestes cartographiques, formes de l’attention et mises en récit revitalisent les imaginaires collectifs en questionnant les modèles de représentation et de narration en vigueur, depuis la sauvegarde d’une salle de cinéma jusqu’à un protocole de création détournant la commande publique vers la discussion collective.
Alice Leroy
Depuis sa création, le festival parlé accueille les performances, projections et interventions des artistes-chercheurs du programme doctoral SACRe : cette année, Sophie Larger et Lucile Cornet-Richard.
L’ensemble des discussions et des propositions artistiques donne lieu à une publication aux Éditions de l’Œil.
-

FORMES COMMUNES
-

L’HORIZON DES COMMUNS
-
-
-
Journée Réel Université
La Journée Réel Université est l’occasion pour les étudiants en Cinéma et leurs enseignants, qu’ils soient en école d’art ou à l’université, en master pratique ou théorique, de s’interroger sur la pratique documentaire, la formation à cette pratique et l’espace de recherche qu’elle constitue.
La journée Réel Université de la 46e édition de Cinéma du réel se déroule lundi 25 mars 2024.
Programme :
9h30 – 12h30 : Table ronde – Quelles médiations pour dire le politique ? L’intime en exemple
13h : Déjeuner
14h : Projection de Carne viva de Jean-Charles Hue, 97′ (2009)
16h : Masterclass du réalisateur Jean-Charles Hue
18h30 – 19h30 : Apéro Étudiants -

MASTERCLASS Jean-Charles Hue
-

QUELLES MÉDIATIONS POUR DIRE LE POLITIQUE ? L’INTIME EN EXEMPLE
-
-
-
Restitution d'atelier
-

RESTITUTION - DOCUMENTAIRES SONORES
-