Rendre compte du documentaire comme un cinéma de la mise en scène. C’est à partir de cette volonté que s’est imposée l’idée cette année de présenter le travail de trois cinéastes qui sur la cartographie du cinéma se trouvent à des coins opposés du territoire : la première rétrospective française de Claudia von Alemann, cinéaste essentielle du mouvement féministe en Allemagne, qui ne craint pas de mêler les langages et les dispositifs narratifs pour créer une œuvre au croisement des territoires du politique, de l’expérience commune et de l’intime ; James Benning, figure essentielle du cinéma indépendant américain, arpenteur de l’Amérique et témoin de son histoire, qui fait vivre au spectateur l’expérience du temps et de l’espace, de ce que le paysage contient de récit et cache d’événements ; Jean-Charles Hue, qui entre fiction et documentaire, nous plonge au cœur d’une réalité tourmentée, dangereuse, intense, au côté des Yéniches en France ou des laissés pour compte à Tijuana. Le cinéma documentaire est ainsi un vaste territoire aux frontières flottantes, poreuses, aux expérimentations tant formelles que narratives. Ce sont ces expérimentations singulières dont la compétition tente de rendre compte à travers un ensemble de films français et étrangers, longs et courts métrages, de jeunes cinéastes ou de réalisateurs reconnus. C’est aussi l’expérimentation qui est le dénominateur commun de la sélection des premiers gestes documentaires remarquables présentés dans Première Fenêtre par ceux qui seront les cinéastes de demain. Les programmations Front(s) populaire(s) et les séances spéciales complètent cet ensemble de films contemporains qui questionnent et légendent le monde que nous habitons. C’est à un cheminement plus anarchique, sans distinction, que nous invitons aussi les spectateurs de Cinéma du réel. Comme dans un système rhizomatique les films se complètent, les films se regardent : « des films qui se donnent la main » était l’expression de Marie-Pierre Duhamel. Des films qui remettent en jeu les tensions de notre contemporain, en font émerger l’âpre complexité, le frottement, et en même temps l’évidence. Évidence de la persistance coloniale à laquelle sont confrontées les populations des territoires d’outre-mer, comme le racontent les films tournés en Guadeloupe par Martine Delumeau et Malaury Eloi Paisley, à la Réunion par Cécile Laveissière et Jean-Marie Pernelle ou à la Martinique par Florence Lazar. Évidence de la persistance coloniale qui émerge peu à peu de Dahomey, le film de Mati Diop qui ouvre cette année le festival. Le colonialisme toujours dans Soundtrack of a Coup d’Etat, qui fait le lien entre le mouvement des droits civiques aux États-Unis et les luttes d’indépendance en Afrique. Colonialisme encore avec le film de Raphaël Pillosio, Les mots qu’elles eurent un jour : elles, ces combattantes algériennes, magnifiquement filmées par Yann le Masson à leur sortie de prison. Le portrait de ces femmes modernes, engagées et éprises de liberté en 1962 nous rappelle aussi combien le combat contre le patriarcat est loin d’être nouveau, et loin d’être gagné. De féminisme si tel est le nom de ce combat, il sera également question cette année dans le cadre de la rétrospective consacrée à Claudia von Alemann mais aussi dans les films de Claudine Bories, Natacha Thiéry, Sabine Groenewegen, Kumjana Novakova notamment. Occasion de s’arrêter un instant sur l’expérience politique des femmes cinéastes à travers leurs films et leur parcours. Et puis il y a Gaza, non pas l’événement qui vient tout à coup faire irruption et comme un moment de stupeur interrompre le cours de nos existences, mais comme quelque chose qui nous arrive à tous et reconfigure notre lecture du temps présent, des relations humaines et de notre rapport au monde. C’est aussi à l’aune de ce qu’il se passe à Gaza, ici et maintenant, que nous regardons, non seulement les films tournés en Palestine, mais aussi à Sarajevo ou au Haut-Karabagh. Catherine Bizern
-
-
Works-in-Progress 2024
Les films en cours, français et internationaux, sont sélectionnés en fonction de leur étape de fabrication, de leurs besoins et potentiel en termes de diffusion, et de leur concordance avec la ligne éditoriale de Cinéma du réel.
Les films en cours sélectionnés ont l’opportunité d’être projetés, une fois, en intégralité, entre le 27 et le 28 mars 2024, au Centre Pompidou.
Le public de professionnels est constitué d’experts français et internationaux soigneusement sélectionnés, jouant un rôle actif et stratégique pour la visibilité des films : programmateurs de festivals, agents de vente, programmateurs TV, distributeurs salle, plateformes web et exploitants.
Chaque projection est suivie d’un temps d’échange, prenant la forme d’une rencontre informelle.
Avec une offre cousue main, ParisDOC Works-in-Progress est une occasion unique pour les porteurs de projets de réfléchir et de construire le parcours de leur film dans un environnement propice, et pour les professionnels d’accéder en exclusivité à de nouveaux projets prometteurs.
___
COUP DE COEUR OLANDO – SOUTIEN À LA POST-PRODUCTION
Dans l’objectif de soutenir au mieux les projets sélectionnés, Studio Orlando est partenaire de ParisDOC Works-in-Progress. À ce titre, l’un des projets sélectionnés bénéficie d’un soutien à la post-production (mixage ou étalonnage) du Studio Orlando.
___
EXPERTS
Cinéma du réel invite trois professionnels qui offrent des consultations personnalisées aux porteurs de projets : des feedbacks constructifs à une étape clef du processus de travail.
Richard Copans – Producteur, réalisateur et directeur de la photographie
Antonio Pezzuto – Programmateur de festivals
Claire Simon – Cinéaste___
Nous remercions chaleureusement tous les producteurs et cinéastes qui nous ont soumis leurs films en cours dans le cadre de cet appel à projets.
___
Télécharger le PDF de présentation et le règlement 2024 : ici
Consulter les sélections précédentes de ParisDOC Works-in-Progress : ici -

Adnan
Marie Valentine Regan
-

Green Line - L'Enfant-Chat
Sylvie Ballyot
-

La Chambre d'ombres
Camilo Restrepo
-

Les Sanglières
Elsa Brès
-

Monólogo Colectivo
Jessica Sarah Rinland
-

PEACHES GOES BANANAS!
Marie Losier
-
-
-
Forum public
Ces échanges sont structurés autour d’une thématique choisie par l’association des Amis du Cinéma du réel, qui veille ensuite au bon déroulement des discussions grâce à un groupe de travail constitué spécialement à cet effet. L’objectif du Forum public est de mettre en lumière les préoccupations que rencontrent les professionnels du secteur en France et les enjeux liés à la production documentaire.
Le Forum public de cette 46e édition du festival Cinéma du réel est porté par la question suivante :
La création documentaire, des territoires à défendre
Le documentaire a toujours été un espace d’invention et de renouvellement des formes. Son histoire, de la naissance du cinéma à nos jours, nous rappelle la grande inventivité dont ont fait preuve celles et ceux qui l’ont défendu de son écriture, à sa réalisation, sa production et sa diffusion. Il n’a cessé de frayer son chemin, empruntant différentes formes, du cinéma direct aux films qui conjuguent dans leur mise en scène éléments du réel et fiction. De la salle, aux nouveaux supports de diffusion, en passant par la télévision, il reste un territoire d’expérimentation.
Comment défendre la liberté de création nécessaire à toutes les audaces face aux injonctions possibles du marché ? Comment préserver un espace de création soutenu par les politiques publiques tout en garantissant l’indépendance ?
-

Documentaire et fiction, si loin, si proche
-

Faut-il innover pour se renouveler ?
-

Liberté de création, au risque de l’ingérence politique
-
-
-
Les Matinales
Dans la perspective de favoriser les rencontres entre les professionnels, Cinéma du réel a créé les Matinales. Ces 3 rendez-vous rassemblent aussi bien les cinéastes que les acteurs de la production, de la diffusion et de la recherche, confirmés et émergents, qui font vivre le documentaire contemporain. Ces temps de discussion permettent un retour sur expérience.
-

MATINÉE DES IDÉES : VERS UNE DECROISSANCE VISUELLE ?
-

MONTER : FALSIFIER / RÉVÉLER
-

UN AILLEURS DE L’ART
-
-
-
Rendez-vous du documentaire de patrimoine / La Table Ronde
-
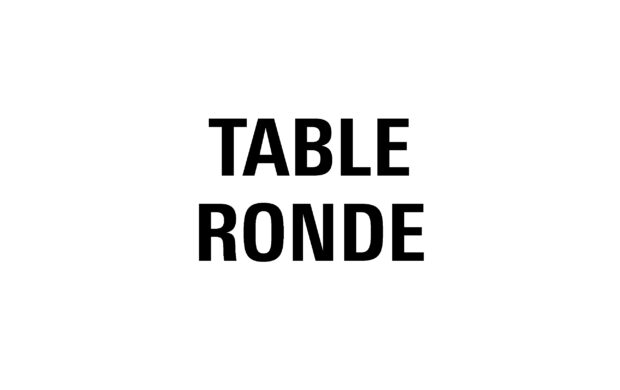
LA RESTAURATION SONORE ET MUSICALE : UNE RECOMPOSITION ?
-
-
-
Rendez-vous du documentaire de patrimoine / Les Projets
-

Matériel et documents cinématographiques d'Ogawa Productions et de Fukuda Katsuhiko
Aikawa Yoichi
Ricardo Matos
-

Centenaire Yannick Bellon
Yannick Bellon
-

Nationalité : immigré
Sidney Sokhona
-

Scenes From The Class Struggle in Portugal
Robert Kramer
Philip Spinelli
-

Warum ist Frau B. glücklich?
Erika Runge
-
-
-
Débats professionnels
Cinéma du réel se veut le lieu où convergent tous les acteurs qui font le cinéma documentaire. A ce titre, le festival accueille trois évènements qui donnent la parole à des associations ou des collectifs afin d’initier au débat.
-

FILMER CONTRE, TOUT CONTRE ?
-

L'Ecole du cinéma documentaire
-

SOUS LES ÉCRANS, LA DÈCHE : LE COLLECTIF DES PRÉCAIRES DES FESTIVALS DE CINÉMA
-